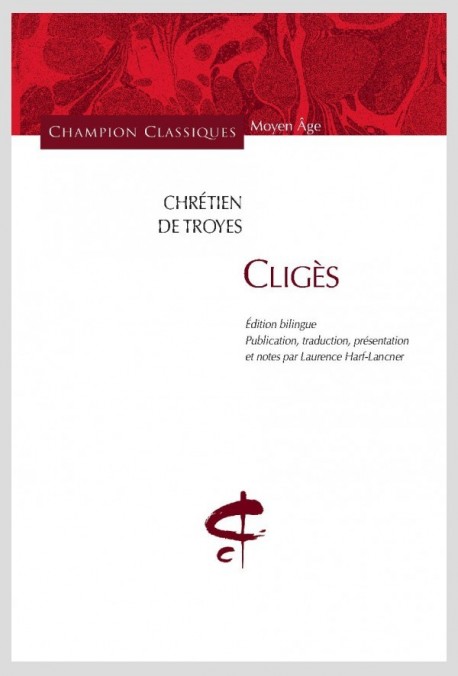Le cycle de Chrétien de Troyes : Cligès ou la Fausse Morte (2/5)
Petite introduction
Bonne année, bonne santé !
On commence donc 2025 avec le deuxième roman de Chrétien de Troyes : Cligès ou la Fausse Morte. (Si vous n’avez pas lu la chronique sur Erec et Enide, le premier roman de Chrétien, c’est par ici). Comme pour bon nombre de manuscrits médiévaux, il est très difficile de donner une date de rédaction précise, mais le manuscrit aurait été écrit vers 1176.
Deuxième roman, pas vraiment, en réalité. Comme je l’avais déjà mentionné dans la chronique précédente, Chrétien de Troyes a rédigé beaucoup d’autres œuvres entre Erec et Enide et Cligès, notamment sa propre version de la légende de Tristan et Iseut. Ces écrits n’ayant – hélas – jamais été retrouvés, nous sommes donc contraints d’ignorer leur existence.
C’est le prologue de Cligès qui nous révèle cette information précieuse : si on en sait toujours aussi peu sur l’auteur, les titres de ses ouvrages perdus nous donnent en revanche quelques informations supplémentaires sur ses centres d’intérêt (et de désintérêt). On sait par exemple qu’il a traduit en ancien français des œuvres d’Ovide, auteur antique toujours apprécié au XIIe siècle. On retrouve en effet quelques motifs ovidiens dans Cligès. Sa réécriture du mythe de Tristan, Del roi Marc et d’Yseult la blonde suggère également que Chrétien n’aimait pas beaucoup cette histoire d’amants maudits. Sans doute préférait-il les dénouements plus gais, mais certains éléments de Cligès tendent à nous laisser croire que Chrétien avait un réel mépris pour Tristan et Iseut.
Je vous explique tout plus bas, bien sûr.
Cligès : mais de quoi ça parle ?
Première partie : Alexandre, fils de l’empereur de Constantinople, décide de partir pour la cour du roi Arthur pour parfaire son entraînement. C’est en effet à Camelot que se trouve la crème de la chevalerie. Après avoir prouvé sa valeur en aidant le roi Arthur à défaire un de ses ennemis, Alexandre tombe amoureux de Soredamor, une des sœurs de Gauvain et suivante de la reine Guenièvre. Le coup de foudre est réciproque, mais aucun des deux jeunes gens n’ose faire le premier pas. Guenièvre s’aperçoit de la situation et, non sans amusement, leur donne un petit coup de pouce. Alexandre épouse Soredamor avec l’assentiment de Gauvain, puis rentre avec elle à Constantinople, mais une mauvaise surprise l’attend : son frère Alis a usurpé le trône en son absence. Un arrangement est vite trouvé : Alis ne devra jamais se marier, et ce, pour que la descendance d’Alexandre puisse hériter du trône, comme il se doit.
Seconde partie : Cligès, fils d’Alexandre et Soredamor, doit succéder à son père, mais Alis rompt son serment en épousant la jeune et belle Fénice, fille de l’empereur d’Allemagne. L’histoire se répète : Cligès et Fénice tombent amoureux, mais n’osent pas avouer leurs sentiments, car leur liaison serait doublement indécente (adultérine et quasi-incestueuse). C’est finalement Fénice qui ose déclarer sa flamme en premier. Elle explique à Cligès qu’elle est toujours vierge grâce à un philtre magique concocté par sa nourrice, Thessala. Ce philtre provoque de puissantes hallucinations érotiques, ce qui permet à Fénice de dormir sur ses deux oreilles pendant qu’Alis rêve. Dès lors, les amants tentent de trouver un moyen de fuir ensemble et de vivre enfin leur passion. Après une nuit de réflexion, Fénice, avec l’aide de Thessala, met au point un étonnant stratagème : celui de se faire passer pour morte…
Critique
J’en ai sûrement un peu trop dévoilé dans mon résumé, mais il fallait bien expliquer qui est Cligès, et ce qu’est cette « Fausse Morte » mentionnée dans le sous-titre de l’œuvre.
Pas de panique : le résumé de la première partie est très succinct, et celui de la seconde partie l’est encore plus.
Ce roman est sans aucun doute le plus original de Chrétien de Troyes. D’abord, l’intrigue se déroule sur deux générations, de sorte qu’on peut découper le roman en deux parties (ce que j’ai d’ailleurs fait dans le résumé). La double narration est aussi présente dans Le Conte du Graal, mais elle sert un objectif différent : la première partie se focalise sur les aventures de Perceval, tandis que la seconde se concentre sur celles de Gauvain.
Ensuite, c’est le seul roman de Chrétien dont l’action ne se déroule pas entièrement dans l’univers arthurien : une bonne partie du roman se déroule à Constantinople, capitale de l’empire byzantin.
Mais pourquoi un tel changement d’ambiance ?
Dans un premier temps, il est important de se souvenir que le XIIe siècle est marqué par les deuxième et troisième croisades. Ensuite, l’Orient était vu comme une terre pleine de merveilles, d’illusions et de richesses : les marchands, pèlerins et chevaliers en croisade rapportaient des épices, des étoffes et d’autres produits alors rares et luxueux pour l’Occident. L’empire byzantin, et particulièrement Constantinople, attirait donc beaucoup de visiteurs et incarnait la magie et l’abondance. Cependant, si l’altérité attire, elle peut aussi faire peur. On ne voyait évidemment pas l’islam d’un bon œil, et les Grecs, bien que chrétiens, n’avaient pas bonne réputation : on les pensait paresseux, perfides et sanguins. Notons que ces clichés persistent encore aujourd’hui à l’égard des habitants du bassin méditerranéen. Qui n’a jamais entendu dire que les Italiens parlent fort ? Que les Corses s’emportent facilement et qu’ils sont rancuniers ? Que les Marseillais sont (trop) francs ?
Le choix de l’empire byzantin était donc évident : puissant, oriental, merveilleux, mais chrétien, de sorte que le lecteur ou l’auditeur occidental puisse tout de même s’identifier aux personnages. L’Autre est ainsi toléré… à condition qu’il renferme une part de Même. En outre, le puissant empire byzantin semble, dans le roman, se soumettre à la Grande-Bretagne : Alexandre quitte Constantinople pour prêter allégeance au roi Arthur, puis l’aide à combattre un traître. C’est le seul roman de Chrétien dans lequel Arthur se montre si actif sur le champ de bataille, et surtout si véhément. En effet, dans les autres romans, Arthur est un roi potiche, un peu bonne pâte, et surtout très passif. La reine Guenièvre est enlevée ? Lancelot et Gauvain s’en chargent. La reine Guenièvre est insultée par un chevalier ? Perceval lave l’offense. Pendant ce temps, Arthur reste sur son trône.
Alors pourquoi Arthur est-il étrangement vigoureux dans Cligès ? Nul doute qu’il fallait démontrer la supériorité de l’Occident sur l’Orient en présentant Arthur en guerrier puissant et sans pitié, aux antipodes du roi sage et indulgent que l’on trouve dans les autres romans. Un jeune byzantin ne pouvait pas se déplacer jusqu’à la cour d’Arthur, roi incarnant la chevalerie dans toute sa perfection… pour y trouver un roi débonnaire et oisif. Alexandre tire son épingle du jeu non pas grâce à sa force, mais grâce à une ruse, au demeurant très similaire au cheval de Troie d’Ulysse. N’oublions pas que les Grecs étaient jugés perfides, mais que la perfidie et la ruse sont les deux faces d’une même pièce. Cligès, en revanche, est bien moins rusé que Fénice, mais la perfidie et la ruse sont aussi des traits jugés féminins.
J’ai déjà mentionné l’influence ovidienne sur le roman, mais l’héritage antique ne s’arrête pas là. La référence la plus évidente est bien évidemment le nom d’Alexandre, en référence à Alexandre le Grand. Très populaire au Moyen Âge, il est l’ultime parangon du guerrier, aussi doué en stratégie que sur le champ de bataille. L’histoire d’Alexandre le Grand est largement diffusée en Orient et en Occident, car il constitue un modèle pour tout homme. Dans la littérature française médiévale, Le Roman d’Alexandre, d’Alexandre de Paris, reste à ce jour le récit le plus complet. Dans le cycle arthurien, Alexandre l’Orphelin est un cousin de Tristan d’une très grande beauté.
Thessala, quant à elle, est décrite comme une magicienne bien meilleure que Médée, et Cligès, comme un jeune homme infiniment plus beau et plus sage que Narcisse. On remarque donc une volonté de s’inscrire dans la lignée antique, tout en affirmant la supériorité du présent.
Passons maintenant à l’un des grands thèmes des romans de Chrétien : l’amour. Tout d’abord, le parallèle entre la première et la seconde partie est saisissant : les jeunes gens tombent amoureux l’un de l’autre au premier regard, mais chacun, par peur du rejet, soupire dans son coin. C’est finalement la jeune fille qui ose se jeter à l’eau.
Dans la première partie, les doutes d’Alexandre et de Soredamor sont la conséquence de l’inexpérience de l’amour.
Alexandre est un redoutable guerrier, mais il n’a jamais jouté contre Amour.
Soredamor est une jeune fille parée de toutes les qualités, mais n’a jamais daigné servir Amour.
Amour s’est vengé en les frappant de ses flèches.
Le motif de la vengeance de l’amour en tant que figure allégorique est très fréquent dans la littérature du XIIe siècle, mais trouve ses racines dans l’Antiquité. Eh oui, vous avez sûrement reconnu Cupidon (ou Eros chez les Grecs) derrière cet archer farceur.

Cupidon, dieu de l’amour, est souvent représenté comme un petit ange nu, armé d’un arc et des flèches.
Rappelez-vous qu’il ne fait pas bon mépriser l’amour au XIIe siècle : le lai du Trot, dont j’ai déjà parlé ici, en est un parfait exemple. Dans Cligès, la jeune fille qui refuse de servir Amour est punie en subissant ses assauts inopinés. En acceptant sa défaite et en admettant qu’elle aime, elle est délivrée de ses tourments et accède au bonheur, ainsi qu’à un statut social bien plus élevé.
Alexandre et Soredamor ont tout de même bénéficié de l’aide de Guenièvre : celle-ci, dans un premier temps, les croit tous deux malades, puis elle finit par comprendre la nature du « mal » qui les ronge. Elle les aide alors à se rapprocher, tout en subtilité. C’est un véritable succès puisque Soredamor se décide enfin à déclarer ses sentiments à Alexandre.
Cligès et Fénice reproduisent le même schéma, mais n’ont pas de Guenièvre pour les épauler. En ce sens, Fénice se montre bien plus hardie que Soredamor, puisqu’elle ose avouer ses sentiments à Cligès sans aide extérieure. Le mérite est d’autant plus grand que leur situation est beaucoup plus complexe : Fénice est mariée à l’oncle de Cligès.
Le jeu de l’amour est donc entièrement dominé par les femmes. Alexandre et Cligès ont beau être des chevaliers accomplis, ils demeurent extrêmement timorés sur le plan amoureux. Alors qu’ils n’osent pas entreprendre par peur du rejet, les jeunes filles osent à leur place, risquant non seulement le rejet, mais aussi leur réputation.
La situation de Cligès et de Fénice rappelle fortement le mythe de Tristan et Iseut : Tristan et Cligès sont tous les deux amoureux de leur tante par alliance. Fénice en est d’ailleurs bien consciente, et refuse d’être une nouvelle Iseut, qu’elle méprise pour son impudicité. On remarquera aussi que, si dans la légende de Tristan et Iseut, le philtre magique déclenche l’amour, chez Cligès, il sert au contraire à empêcher l’amour physique, ce qui permet à Fénice de ne pas reproduire les actions honteuses d’Iseut. Rappelons qu’un mariage non consommé est invalide. Fénice, même vierge, ne commet donc pas de faute. En outre, en prenant femme, Alis rompt son serment et lèse Cligès. Le mariage d’Alis et de Fénice est donc doublement illégitime.
Pour résumer, Cligès est un roman original, en ce qu’il mêle le passé et le présent, l’Orient et l’Occident, la matière antique et la matière de Bretagne, dans lequel les femmes et la magie jouent un rôle essentiel. C’est peut-être le roman de Chrétien de Troyes que je préfère, mais de très peu car chacun de ses romans est exceptionnel.
Plus de détails
Attention, cette partie contient des éléments qui dévoilent l’intrigue. Ne lisez pas si vous ne voulez pas gâcher le plaisir de la découverte.
J’ai conscience que cette chronique est déjà bien longue. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais essayer de me restreindre et d’aller à l’essentiel.
Je voudrais parler plus en détail de la ruse de Fénice, qui constitue le point d’orgue du roman. L’idée de se faire passer pour morte afin de fuir avec son amant est aussi géniale qu’effrayante. Elle est, pour cela, assistée de sa fidèle nourrice Thessala. Celle-ci est non seulement une magicienne hors pair, mais aussi un excellent médecin. Elle parvient, grâce à un autre de ses philtres, à plonger Fénice dans un état faussement léthargique. Seuls trois médecins flairent la supercherie. Ils commencent à torturer Fénice pour la forcer à se réveiller, mais celle-ci résiste. Les dames de la cour, qui assistaient secrètement à la scène, se mettent alors en colère et jettent les médecins par une fenêtre.
Le comportement des trois médecins peut sembler extrême, mais il trouve, encore une fois, ses racines dans l’Antiquité : ils se souviennent d’un conte sur l’une des femmes de Salomon, qui avait simulé la mort pour rejoindre un amant. Ce conte, à l’instar de certains fabliaux médiévaux, met en garde les hommes contre la duplicité des femmes, capables d’élaborer les stratagèmes les plus sournois pour tromper leur mari. Le fait que la victime du conte soit le sage roi Salomon n’est pas anodin : il s’agissait de montrer que même le plus sage des hommes peut se faire piéger par les ruses des femmes.
Les médecins voient donc en Fénice le souvenir de la femme de Salomon, symbole de la perfidie féminine. Leur extrême cruauté pourrait donc s’expliquer par une volonté de punir la femme pécheresse, en la meurtrissant jusque dans son tombeau. Pour quelle autre raison des médecins tortureraient-ils à mort une jeune fille pour prouver qu’elle est en vie ?
Puis les autres dames interviennent et défenestrent les bourreaux, et Fénice, tel le phœnix dont elle tire son nom, renaît et guérit, grâce à un onguent de Thessala. Est-ce un hasard si la « résurrection » de Fénice est due à des femmes ? Les médecins semblent effectivement incarner la tradition misogyne dans sa forme absolue : et si Fénice était réellement morte ?
L’image de Cupidon utilisée dans cet article provient de Pixabay : https://pixabay.com/fr/users/gdj-1086657/. Merci à GDJ.