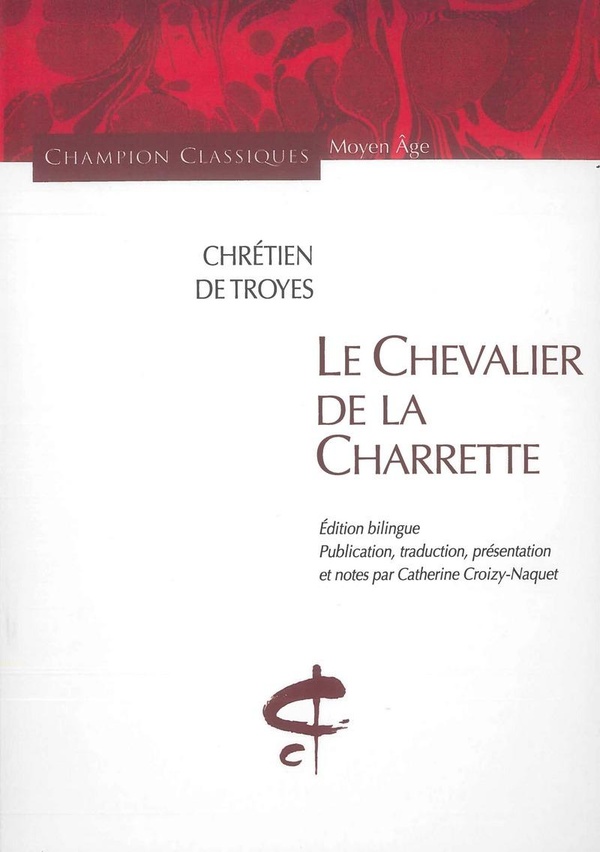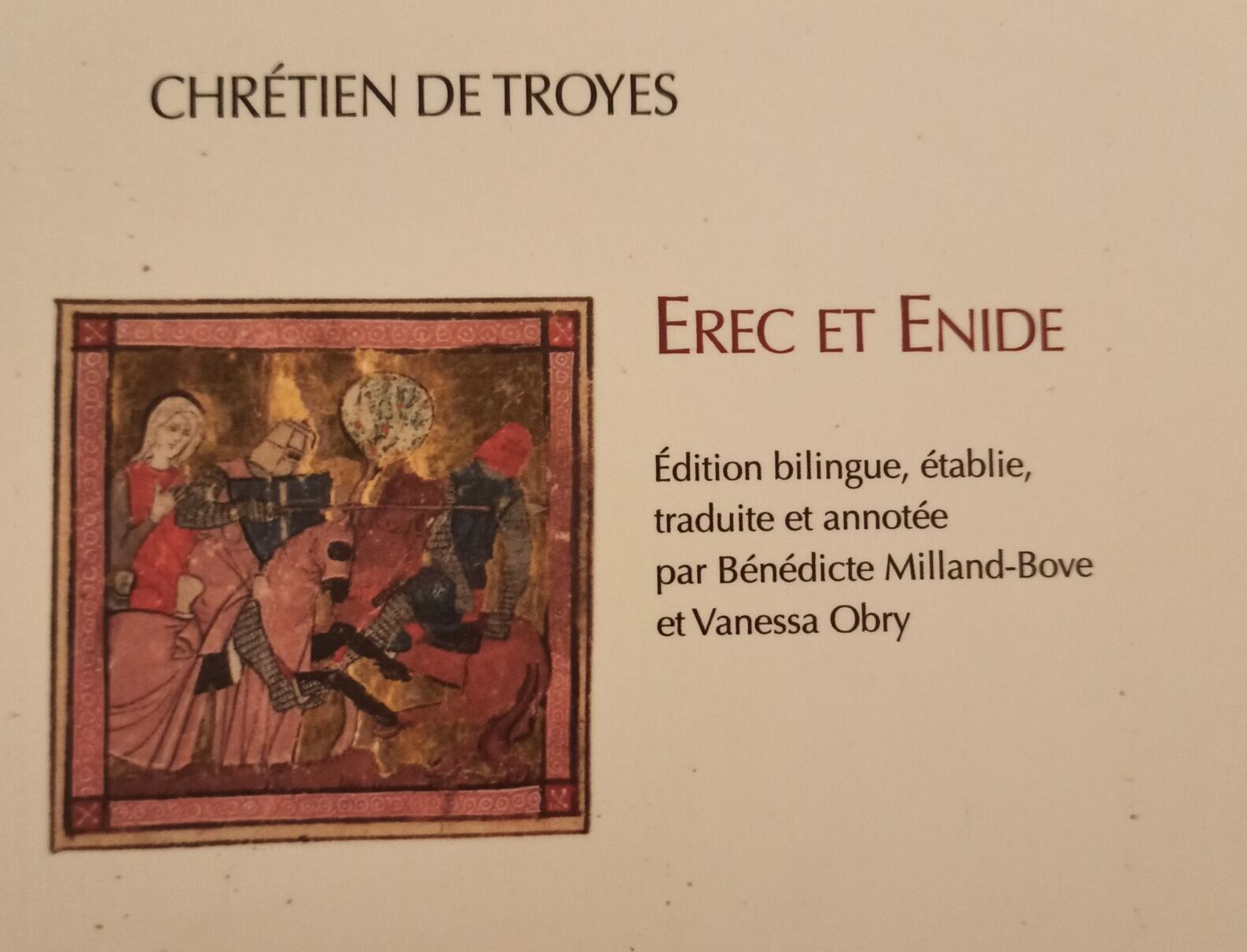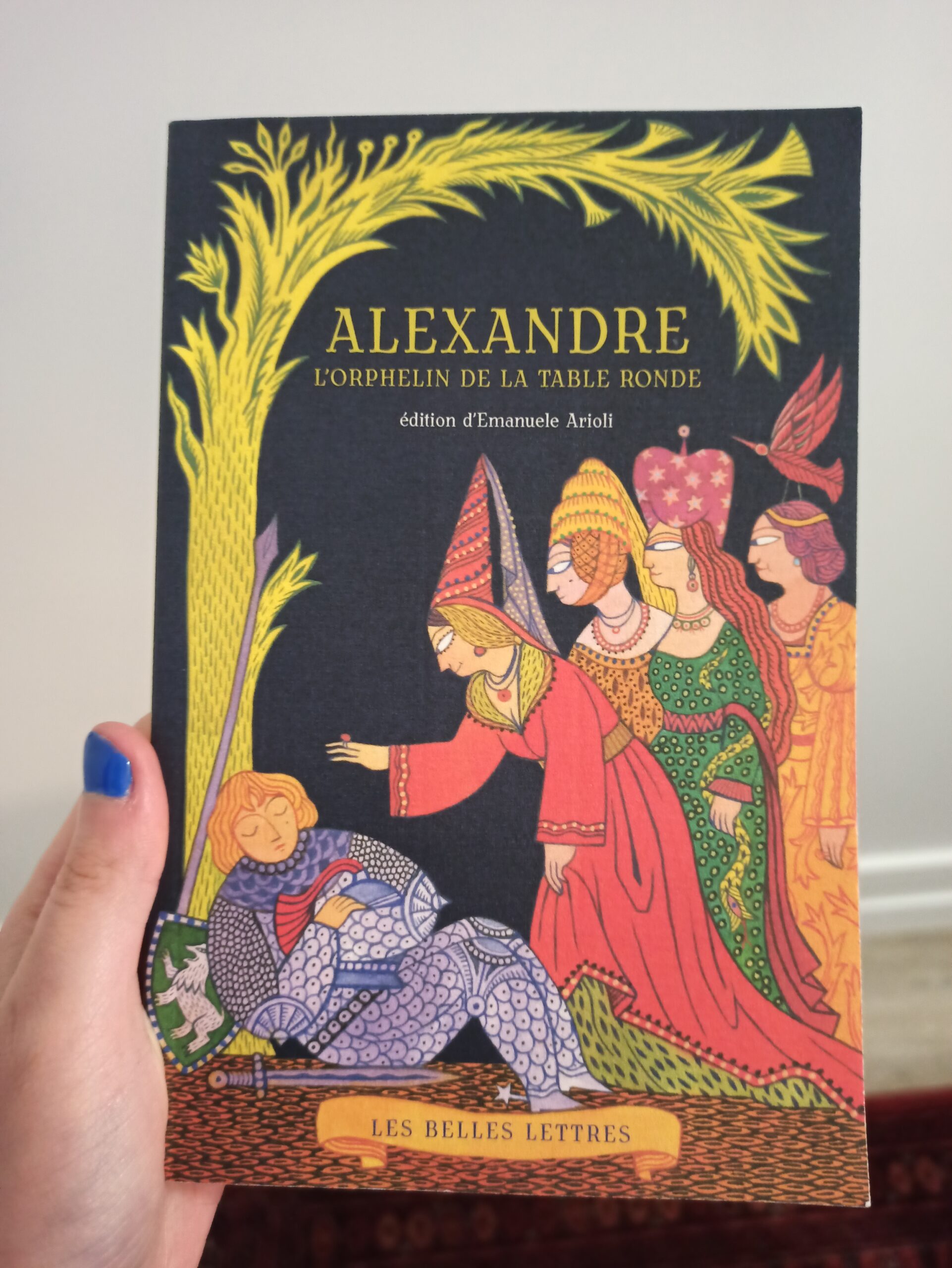Le cycle de Chrétien de Troyes : Le Chevalier de la charrette (3/5)
Introduction
Bonjour tout le monde !
Après Erec et Enide, puis Cligès, nous abordons enfin l’une des œuvres les plus connues de Chrétien de Troyes : Lancelot ou le Chevalier de la charrette. C’est une nouvelle ère qui commence : plus de tendres amants mariés. L’heure est maintenant à l’amour courtois. Et qui, mieux que Lancelot, incarne l’amant idéal ?
Petit rappel sur l’amour courtois : Avant toute chose, il convient de resituer un peu le contexte. L’amour courtois est originaire du duché d’Aquitaine. Nommée fin’amor en langue d’oc, cette nouvelle façon d’aimer se répand ensuite dans tout le Sud à travers les chants des troubadours. C’est Aliénor d’Aquitaine, petite-fille du premier troubadour Guillaume IX, qui contribue très largement à sa diffusion en langue d’oïl. Lorsqu’elle épouse Louis VII, elle fait venir à la cour de France de nombreux troubadours. C’est ainsi que la poésie occitane se répand rapidement dans les territoires d’oïl, et la fin’amor avec.

Répartition entre territoires d’oc et territoires d’oïl
L’amour courtois ébranle la noblesse et modifie complètement les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Ce sont désormais les dames qui mènent le jeu, et les amants qui se soumettent.
Le jeu de l’amour courtois répond à des règles bien définies :
- La dame doit toujours être d’un rang supérieur à l’amant.
- La dame est toujours mariée.
- La dame doit se montrer inaccessible, voire méprisante.
- L’amant doit être entièrement dévoué à sa dame.
- L’amant doit réussir toutes les épreuves que lui impose sa dame, s’il veut espérer une récompense (un simple regard en était déjà une).
- Les deux amants se doivent une fidélité sans faille, la seule exception étant le devoir conjugal de la dame envers son époux.
Lancelot et le Chevalier de la charrette est supposément écrit autour de 1180. Cette fois, le prologue nous donne quelques renseignements non négligeables sur la genèse du roman : Chrétien aurait initié l’écriture de son roman à la demande de Marie de Champagne, sa mécène. La cour de Marie de Champagne, fille d’Aliénor d’Aquitaine, était effectivement le lieu privilégié des poètes et jongleurs au XIIe siècle. Chrétien précise que c’est Marie qui lui a donné les bases de l’intrigue : lui s’est surtout occupé de la mise en forme du roman.
Ce roman est donc une œuvre de commande, ce qui expliquerait pourquoi il est si différent de ses ouvrages précédents. Souvenez-vous, le Chrétien qui a écrit Erec et Enide était en faveur du mariage d’amour. Le Chrétien qui a écrit Cligès méprisait la relation de Tristan et Iseut. Pourtant dans Le Chevalier de la charrette, Chrétien dépeint les amours adultères de Lancelot, chevalier de la Table ronde, et de la reine Guenièvre. Si ce n’est pas un virage à 180 degrés…
Il faut toutefois préciser que Chrétien n’a jamais terminé son roman, préférant déléguer la fin de la rédaction à Godefroy de Bouillon. Est-ce la preuve que Chrétien n’aimait pas ce qu’il écrivait ? Peut-être.
Autre innovation : le personnage de Lancelot du Lac. Eh oui, l’un des chevaliers les plus connus de la légende arthurienne a été entièrement créé par Chrétien de Troyes. Ou bien Marie de Champagne ?
Lancelot ou le Chevalier de la charrette : mais de quoi ça parle ?
Un chevalier du nom de Méléagant enlève la reine Guenièvre, le sénéchal Keu, ainsi que plusieurs gens du royaume de Logres. Il annonce être le fils du roi Baudemagu, souverain du royaume de Gorre, dont nul ne revient jamais. Attristé, Arthur envoie Gauvain les délivrer. En chemin, celui-ci rencontre un chevalier anonyme, prêt à tout pour libérer la reine (on apprend plus tard dans le roman qu’il s’appelle Lancelot du Lac). Les deux chevaliers s’associent et partent donc pour le royaume de Gorre. Bientôt, ils rencontrent un nain menant une charrette, qui accepte de les escorter jusqu’à Gorre à la seule condition que les chevaliers montent dans la charrette. Gauvain refuse aussitôt, la charrette étant associée à la honte et aux condamnés à mort. Après une brève hésitation, le deuxième chevalier accepte de monter dans la charrette, et le nain consent à les emmener. Lancelot est insulté et hué par toutes les personnes qu’ils croisent, mais cela leur permet de parvenir jusqu’à Gorre, où de nombreuses autres épreuves les attendent encore…
Critique
Le scénario est bien plus simple que les romans précédents. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Si l’intrigue réserve peu de surprise, le roman n’en est pas dénué d’intérêt pour autant. Le Chevalier de la charrette est la quintessence même de l’amour courtois. Quiconque voudrait en savoir plus à ce sujet trouvera parfaitement son bonheur en lisant ce roman.

Le topos du chevalier au secours de la belle princesse est encore présent à notre époque, sous des formes plus modernes.
On remarquera tout de même que Guenièvre est très différente des autres romans. Dans Erec et Enide et Cligès, ce sont surtout ses qualités de reine et sa sagesse qui sont mises en avant. Elle est toujours d’excellent conseil, se montre très avisée et sa valeur auprès d’Arthur et des chevaliers n’est plus à prouver. N’oublions pas qu’elle est aussi une très bonne entremetteuse.
Mais, quelles sont les caractéristiques d’une dame courtoise, déjà ? La hauteur, et un certain mépris pour le soupirant. Une Guenièvre courtoise, très accessible et agréable (ce qu’elle est dans les autres romans) ne correspondait évidemment pas à cette femme-image presque irréelle.
Pour la petite anecdote, Le Chevalier de la charrette a été le premier roman de Chrétien de Troyes que j’ai lu. J’avais donc découvert Guenièvre dans ce roman, sous son masque de dame hautaine et presque cruelle, et l’avais trouvée fortement antipathique. Heureusement, les autres romans m’ont réconciliée avec le personnage.
Mais plus la dame est distante, plus le chevalier souhaite se démarquer, et plus il acquiert de la valeur. Autrement dit, même si le comportement de Guenièvre (et de l’amante courtoise en général) n’est pas des plus sympathiques, il est essentiel pour que l’amant devienne la meilleure version de lui-même. Pour plus de détails, voir dans la rubrique « Pour aller plus loin ».
Lancelot, quant à lui, se distingue des précédents héros de Chrétien : Erec aime Enide, mais se montre parfois brutal. Alexandre est très rusé, mais n’ose pas approcher Soredamor par peur d’être rejeté. Cligès n’est pas très débrouillard en amour, et laisse Fénice agir.
Lancelot, lui, possède non seulement une force colossale, mais aussi une très grande sensibilité. Amusez-vous à compter combien de fois Lancelot s’évanouit. Son amour extrême pour Guenièvre en fait un chevalier déterminé, prêt à combattre n’importe quel ennemi et à subir le déshonneur. Pourtant, on ne sait pas si Chrétien trouve son chevalier admirable ou ridicule : Lancelot est mis en danger plusieurs fois à cause de ses pensées amoureuses, frôlant parfois la mort de manière risible. De bien des manières, il partages quelques traits de similarité avec Aucassin, dont on a déjà parlé. Le contraste avec Méléagant est saisissant. Ce dernier dit aimer la reine, mais toutes ces actions semblent démontrer le contraire. Lancelot incarne l’amant « contemporain », tandis que Méléagant rappelle le prédateur antique, qui semble privilégier le rapt et la captivité.
Lancelot partage un lien étroit avec la féminité, plus que n’importe quel chevalier : pendant tout le roman, il n’aura de cesse d’inspirer de l’amour aux femmes et jeunes filles qu’il croise. C’est d’ailleurs Guenièvre qui révèle son nom, et suite à cela, une demoiselle l’interpelle en plein combat, divulguant à tous son identité. Dans sa quête, Lancelot rencontre beaucoup de jeunes filles, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Ces demoiselles semblent omniscientes puisqu’elles sont toutes au courant de la relation entre Lancelot et Guenièvre, pourtant cachée. Certaines tentent de le détourner de sa quête pour éprouver sa fidélité, notamment une demoiselle qui cherche à le séduire. Mais ces demoiselles sont toutes, au bout du compte, des personnages adjuvants et informateurs.
Le Chevalier de la charrette introduit aussi quelques éléments que Chrétien développe peu, mais qui seront très largement repris par les continuateurs. On sait par exemple, dans le roman, que Lancelot a été élevé par une fée, la Dame du Lac, et que celle-ci lui a donné un anneau magique permettant de lever des sortilèges. C’est ainsi que l’enfance de Lancelot et son lien avec la Dame du Lac seront développés au XIIIe siècle par d’autres auteurs. La Dame du Lac sera alors associée à Viviane/Niniane, la fée à l’origine de la disparition de Merlin.
Pour aller plus loin
Attention, cette partie contient des éléments susceptibles de dévoiler l’intrigue. Ne lisez pas si vous ne voulez pas gâcher le plaisir de la découverte.
Au sujet de la relation courtoise entre Lancelot et Guenièvre : Comme dit précédemment, la liaison de Lancelot et Guenièvre suit le schéma bien précis de la relation courtoise : de nature adultère, femme hautaine socialement supérieure à l’amant. Elle paraît parfois presque éprouver un plaisir sadique à humilier Lancelot : lorsque Lancelot parvient enfin à se retrouver en tête à tête avec Guenièvre, celle-ci le rejette violemment, sans aucune raison apparente. Plus tard, elle explique qu’elle voulait juste faire a gas (plaisanter, faire une blague), et qu’elle cherchait à lui faire payer son hésitation, même brève, à monter dans la charrette. Plus tard, lors du tournoi de Noauz, elle aperçoit un chevalier qu’elle soupçonne être Lancelot et, pour s’assurer de son identité, lui ordonne par le biais d’une suivante de faire deux fois « au pire ». Contraint d’obéir à sa dame, Lancelot se bat du pire qu’il peut, attirant sur lui les moqueries du public.
Cependant, contrairement à bon nombre d’amants courtois, Lancelot a obtenu l’«ultime récompense» plutôt rapidement, puisque Guenièvre lui donne un rendez-vous de nuit au château de Baudemagu, avant de lui proposer de la rejoindre dans sa chambre. Malgré son filtre d’amante courtoise, on sent tout de même qu’elle aime véritablement Lancelot. Lors d’un épisode, Guenièvre et Lancelot croient tous deux que l’autre est mort à causse de fausses rumeurs. Guenièvre tombe malade et Lancelot tente de se suicider. Si le thème du « suicide sur un malentendu » rappelle fortement Roméo et Juliette, il s’agit en fait d’une référence à Pyrame et Thisbé, une légende antique dont je parlerai une autre fois.
Lancelot et les personnages féminins : Lancelot est fait prisonnier deux fois dans le roman, sous les ordres de Méléagant, son ennemi juré. Mais il est intéressant de constater que ses libérations sont toujours dues à des femmes. La première consent à le laisser s’échapper discrètement pour participer à un tournoi, la seconde est une soeur de Méléagant qui voulait remercier Lancelot pour un service rendu. Elle part à sa recherche, et trouve sans aucun mal la tour dans laquelle il est emprisonné. Elle le soigne et lui offre un nouveau destrier. Emu, Lancelot consent à lui donner son amour. Elle est donc la seule femme, mise à part Guenièvre, qui a obtenu ce privilège. Notons que Guenièvre n’apparaît plus dans le roman après cet épisode. Il semblerait que Chrétien n’ait pas pu s’empêcher de renouer avec ses habitudes. La postérité n’a cependant pas retenu cette « correction », préférant le couple Lancelot/Guenièvre pour sa portée dramatique.
Les deux images de cet article proviennent respectivement de Wikipédia et Flickr.